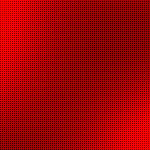L’esquif des hautes tours rasait le sombre faîte.
On eût dit à leur foule, à leurs sommets pressés,
En aiguilles, en arcs, en minarets dressés,
Une forêt de pierre où les granits, les marbres,
Auraient germé d’eux-même et végétaient en arbres :
Pyramides, palais bâtis pour des géants,
Ponts immenses montant sur leurs cintres béants,
Arcs sur arcs élevant de larges plates-formes ’
Servant de piédestal à des monstres énormes,
Obélisques taillés dans un bloc seulement,
Arrachés de la terre ainsi qu’un ossement,
Et sans rien supporter s’amincissant en glaive,
Dans le ciel étonné se perdant comme un rêve !
Aqueducs où grondait le fleuve aux grandes eaux,
Jardins aériens portés sur mille arceaux,
Dont les arbres géants, plus hauts que nos idées,
Jetaient sur les palais l’ombre de cent coudées !
Colonnades suivant, comme un serpent d’airain,
Des coteaux aux vallons les grands plis de terrain,
Où des troncs de métal, prodigieuses plantes,
Portaient à leurs sommets des feuillages d’acanthes ;
Des vases où fumaient des bûchers d’aloès
Pour embaumer, la nuit, la brise des palais,
Ou d’éclatants foyers, flammes pyramidales,
Ondoyant sous les vents, reluisaient sur les dalles.
Le navire, voguant sur ces mouvants réseaux,
Comme un aigle au milieu de cent mâts de vaisseaux,
Craignait à chaque instant de déchirer sa quille
Contre une pyramide, une tour, une aiguille.
A travers ce dédale il dirigeait son vol,
Aux mille cris d’effroi qui s’élevaient du sol,
Vers le centre éclatant des dieux, forte demeure,
Qui dominait de haut la ville inférieure.
Là, planant de plus bas sur le sacré séjour
Où les chefs s’enfermaient dans leur jalouse cour,
Ils virent, aux clartés de cent torches errantes,
Dans un jardin coupé de sources murmurantes,
Aux brises sans repos d’accords mélodieux,
Un innombrable essaim de déesses, de dieux,
Les regardant tomber comme file une étoile,
Et d’un immense cri faisant trembler leur voile.
Mais avant que l’esquif, un moment suspendu,
Fût au niveau des murs de marbre descendu,
Celui qui paraissait régner sur cette foule
Fit un geste : aussitôt, comme la feuille roule
Quand le vent du midi qui vient la balayer
L’amoncelle en courant et la fait ondoyer,
Par le geste écartés, ces hommes et ces femmes,
Montrant dans leur pâleur tout l’effroi de leurs âmes,
Sans oser vers le ciel détourner un regard,
Du jardin interdit s’enfuirent au hasard.
Le roi seul, entouré par un groupe céleste
De femmes, de géants, indique par un geste
Au pilote attentif le sommet d’une tour
Dont les créneaux d’ivoire enfermaient le contour ;
Il y monte â pas lents d’étages en étages,
Et le navire enfin y descend des nuages !
Sitôt qu’il eut touché terre comme un oiseau,
La voile s’abaissa sur son mât de roseau,
Et des flancs affaissés de l’obscure nacelle,
Comme des bords penchés d’un vaisseau qui chancelle,
Les géants descendus saluèrent leur roi ;
Débarquant les captifs immobiles d’effroi.
Comme des chiens dressés traînent, souillé d’écume,
Blessé, sanglant, l’oiseau dont ils mordent la plume,
Ils portèrent meurtris, dans leurs bras triomphants,
Aux pieds du roi des dieux le couple et les enfants.
L’aspect inattendu de cette jeune proie
Arrache à tous un cri de surprise et de joie ;
Un silence succède à ce ravissement.
Aux clartés d’un flambeau promené lentement,
Qui dans l’obscurité frappant chaque visage
Semblait faire sortir un ange d’un nuage,
Les deux bras soulevés par l’admiration,
Les géants l’exhalaient en exclamation.
Ils dévoraient des yeux, dans leur amour sans âme.
Le torse aérien de cette jeune femme,
Ces membres qu’ombrageaient, de sa tête à ses pies,
Par l’haleine des nuits ses cheveux dépliés ;
Ces épaules de marbre, où des frissons de crainte
De ses sensations faisaient courir l’empreinte ;
Ces bras qui se tordaient d’horreur sur les carreaux,
Et d’un geste impuissant repoussaient les bourreaux ;
Ce cou dont la tristesse alanguissait la courbe,
Comme un palmier pliant sous le fruit qui le courbe ;
Cette bouche entrouverte, aux deux bords de vermeil,
Grenade de damas éclatée au soleil,
Et d’où semblait sortir, avec sa faible haleine,
De souffrance et de doute une âme toute pleine ;
Ce pli de la douleur entre ses deux sourcils,
Ces perles qui brillaient sur le bord de ses cils ;.
La pâleur de l’effroi, la rougeur de la honte,
Répondant sur sa joue au regard qui l’affronte ;
Vers Cédar enchaîné ces soupirs étouffants ;
Ce sourire de mère à ses pauvres enfants ;
Et ces yeux où l’éclat de cette torche errante
Brillait comme un reflet de feu dans l’eau courante,
Et laissait voir au fond de leur morne splendeur
Comme un monde infini d’amour et de candeur !
Ensuite s’arrachant à la céleste image,
Et portant la clarté sur un autre visage,
Ils contemplaient Cédar immobile à leurs piés,
Entourant des deux bras ses genoux repliés,
Et, comme pour cacher l’âme sur sa figure,
Laissant pendre en flots courts sa noire chevelure.
Sous le fer, en anneaux sur ses membres rivé,
Son beau corps s’affaissait ; mais s’il s’était levé,
On voyait que sa haute et robuste stature
Eût dépassé les dieux de toute la ceinture.
Les lourds anneaux de fer tordus par ses efforts
De quelque tache bleue avaient souillé son corps ;
Mais de ce corps charmant la forte adolescence,
Dont la grâce partout relevait la puissance,
De ses muscles naissants les palpitations
Dont le regard suivait les ondulations,
Dans un jeune olivier comme on suit sous l’écorce
Les membrures du tronc qui révèlent sa force ;
La blancheur de sa peau qu’un frissonnant duvet,
Comme une ombre ondoyante, à peine relevait ;
De son front foudroyé la beauté tendre et mâle,
La jeunesse et la mort luttant sur son teint pâle ;
Son corps qui semblait à du ciel précipité,
Sa taille, sa splendeur, son immobilité,
Le faisaient ressembler à la pâle statue
De quelque dieu de marbre à nos pieds abattue,
Dont les lézards rampants craignent de s’approcher,
Et qu’en la mesurant la main n’ose toucher.
Insensible au regard qui tombait sur lui-même,
Quand le géant orné du divin diadème,
Jetant sur Daïdha un coup d’oeil de trop près,
D’un avide regard profanait ses attraits,
Il relevait soudain son front mélancolique,
Contractait son sourcil sur son regard oblique ;
On voyait dans son oeil son esprit flamboyer :
Cet éclair contenu paraissait foudroyer,
Et ses fers, secoués d’un bond involontaire,
Sonnaient comme un faisceau que le vent jette à terre ;
Les reines pâlissaient de frisson, et le roi
Laissait tomber la torche et reculait d’effroi !
Tel quand un bûcheron dans un chêne encor tendre,
Après l’avoir coupé, met le coin pour le fendre,
Dans le tronc entr’ouvert s’il enfonce les doigts
Pour voir saigner la sève et se tordre le bois,
Les deux bords rapprochés de la profonde entaille
Saisissent tout à coup l’homme dans leur tenaille ;
Vainement il secoue un bras désespéré ;
L’arbre emporte la main qui l’avait déchiré.
 Cultivons nous
Cultivons nous