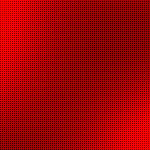La Haine est le tonneau des pâles Danaïdes;
La Vengeance éperdue aux bras rouges et forts
A beau précipiter dans ses ténèbres vides
De grands seaux pleins du sang et des larmes des morts,
Le Démon fait des trous secrets à ces abîmes,
Par où fuiraient mille ans de sueurs et d’efforts,
Quand même elle saurait ranimer ses victimes,
Et pour les pressurer ressusciter leurs corps.
La Haine est un ivrogne au fond d’une taverne,
Qui sent toujours la soif naître de la liqueur
Et se multiplier comme l’hydre de Lerne.
– Mais les buveurs heureux connaissent leur vainqueur,
Et la Haine est vouée à ce sort lamentable
De ne pouvoir jamais s’endormir sous la table.
LXXIV – LA CLOCHE FÊLÉE
II est amer et doux, pendant les nuits d’hiver,
D’écouter, près du feu qui palpite et qui fume,
Les souvenirs lointains lentement s’élever
Au bruit des carillons qui chantent dans la brume.
Bienheureuse la cloche au gosier vigoureux
Qui, malgré sa vieillesse, alerte et bien portante,
Jette fidèlement son cri religieux,
Ainsi qu’un vieux soldat qui veille sous la tente !
Moi, mon âme est fêlée, et lorsqu’en ses ennuis
Elle veut de ses chants peupler l’air froid des nuits,
II arrive souvent que sa voix affaiblie
Semble le râle épais d’un blessé qu’on oublie
Au bord d’un lac de sang, sous un grand tas de morts
Et qui meurt, sans bouger, dans d’immenses efforts.
LXXV – SPLEEN
Pluviôse, irrité contre la ville entière,
De son urne à grands flots verse un froid ténébreux
Aux pâles habitants du voisin cimetière
Et la mortalité sur les faubourgs brumeux.
Mon chat sur le carreau cherchant une litière
Agite sans repos son corps maigre et galeux;
L’âme d’un vieux poète erre dans la gouttière
Avec la triste voix d’un fantôme frileux.
Le bourdon se lamente, et la bûche enfumée
Accompagne en fausset la pendule enrhumée
Cependant qu’en un jeu plein de sales parfums,
Héritage fatal d’une vieille hydropique,
Le beau valet de coeur et la dame de pique
Causent sinistrement de leurs amours défunts.
LXXVI – SPLEEN
J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans.
Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans,
De vers, de billets doux, de procès, de romances,
Avec de lourds cheveux roulés dans des quittances,
Cache moins de secrets que mon triste cerveau.
C’est une pyramide, un immense caveau,
Qui contient plus de morts que la fosse commune.
– Je suis un cimetière abhorré de la lune,
Où comme des remords se traînent de longs vers
Qui s’acharnent toujours sur mes morts les plus chers.
Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées,
Où gît tout un fouillis de modes surannées,
Où les pastels plaintifs et les pâles Boucher
Seuls, respirent l’odeur d’un flacon débouché.
Rien n’égale en longueur les boiteuses journées,
Quand sous les lourds flocons des neigeuses années
L’ennui, fruit de la morne incuriosité
Prend les proportions de l’immortalité.
– Désormais tu n’es plus, ô matière vivante !
Qu’un granit entouré d’une vague épouvante,
Assoupi dans le fond d’un Sahara brumeux
Un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux,
Oublié sur la carte, et dont l’humeur farouche
Ne chante qu’aux rayons du soleil qui se couche.
LXXVII – SPLEEN
Je suis comme le roi d’un pays pluvieux,
Riche, mais impuissant, jeune et pourtant très vieux,
Qui, de ses précepteurs méprisant les courbettes,
S’ennuie avec ses chiens comme avec d’autres bêtes.
Rien ne peut l’égayer, ni gibier, ni faucon,
Ni son peuple mourant en face du balcon.
Du bouffon favori la grotesque ballade
Ne distrait plus le front de ce cruel malade;
Son lit fleurdelisé se transforme en tombeau,
Et les dames d’atour, pour qui tout prince est beau,
Ne savent plus trouver d’impudique toilette
Pour tirer un souris de ce jeune squelette.
Le savant qui lui fait de l’or n’a jamais pu
De son être extirper l’élément corrompu,
Et dans ces bains de sang qui des Romains nous viennent,
Et dont sur leurs vieux jours les puissants se souviennent,
II n’a su réchauffer ce cadavre hébété
Où coule au lieu de sang l’eau verte du Léthé
LXXVIII -SPLEEN
Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle
Sur l’esprit gémissant en proie aux longs ennuis,
Et que de l’horizon embrassant tout le cercle
II nous verse un jour noir plus triste que les nuits;
Quand la terre est changée en un cachot humide,
Où l’Espérance, comme une chauve-souris,
S’en va battant les murs de son aile timide
Et se cognant la tête à des plafonds pourris;
Quand la pluie étalant ses immenses traînées
D’une vaste prison imite les barreaux,
Et qu’un peuple muet d’infâmes araignées
Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux,
Des cloches tout à coup sautent avec furie
Et lancent vers le ciel un affreux hurlement,
Ainsi que des esprits errants et sans patrie
Qui se mettent à geindre opiniâtrement.
– Et de longs corbillards, sans tambours ni musique,
Défilent lentement dans mon âme; l’Espoir,
Vaincu, pleure, et l’Angoisse atroce, despotique,
Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.
LXXIX – OBSESSION
Grands bois, vous m’effrayez comme des cathédrales;
Vous hurlez comme l’orgue; et dans nos coeurs maudits,
Chambres d’éternel deuil où vibrent de vieux râles,
Répondent les échos de vos De profundis.
Je te hais, Océan ! tes bonds et tes tumultes,
Mon esprit les retrouve en lui; ce rire amer
De l’homme vaincu, plein de sanglots et d’insultes,
Je l’entends dans le rire énorme de la mer
Comme tu me plairais, ô nuit ! sans ces étoiles
Dont la lumière parle un langage connu !
Car je cherche le vide, et le noir, et le nu !
Mais les ténèbres sont elles-mêmes des toiles
Où vivent, jaillissant de mon oeil par milliers,
Des êtres disparus aux regards familiers.
LXXX – LE GOÛT DU NÉANT
Morne esprit, autrefois amoureux de la lutte,
L’Espoir, dont l’éperon attisait ton ardeur
Ne veut plus t’enfourcher ! Couche-toi sans pudeur
Vieux cheval dont le pied à chaque obstacle butte.
Résigne-toi, mon coeur; dors ton sommeil de brute.
Esprit vaincu, fourbu ! Pour toi, vieux maraudeur,
L’amour n’a plus de goût, non plus que la dispute
Adieu donc, chants du cuivre et soupirs de la flûte !
Plaisirs, ne tentez plus un coeur sombre et boudeur !
Le Printemps adorable a perdu son odeur !
Et le Temps m’engloutit minute par minute
Comme la neige immense un corps pris de roideur
– Je contemple d’en haut le globe en sa rondeur
Et je n’y cherche plus l’abri d’une cahute.
Avalanche, veux-tu m’emporter dans ta chute ?
LXXXI – ALCHIMIE DE LA DOULEUR
L’un t’éclaire avec son ardeur,
L’autre en toi met son deuil, Nature !
Ce qui dit à l’un: Sépulture !
Dit à l’autre: Vie et splendeur !
Hermès inconnu qui m’assistes
Et qui toujours m’intimidas,
Tu me rends l’égal de Midas,
Le plus triste des alchimistes;
Par toi je change l’or en fer
Et le paradis en enfer;
Dans le suaire des nuages
Je découvre un cadavre cher,
Et sur les célestes rivages
Je bâtis de grands sarcophages.
LXXXII – HORREUR SYMPATHIQUE
De ce ciel bizarre et livide,
Tourmenté comme ton destin,
Quels pensers dans ton âme vide
Descendent ? réponds, libertin.
– Insatiablement avide
De l’obscur et de l’incertain,
Je ne geindrai pas comme Ovide
Chassé du paradis latin.
Cieux déchirés comme des grèves
En vous se mire mon orgueil;
Vos vastes nuages en deuil
Sont les corbillards de mes rêves,
Et vos lueurs sont le reflet
De l’Enfer où mon coeur se plaît.
LXXXIII – L’HÉAUTONTIMOROUMÉNOS
A J.G.F.
Je te frapperai sans colère
Et sans haine, comme un boucher,
Comme Moïse le rocher
Et je ferai de ta paupière,
Pour abreuver mon Saharah
Jaillir les eaux de la souffrance.
Mon désir gonflé d’espérance
Sur tes pleurs salés nagera
Comme un vaisseau qui prend le large,
Et dans mon coeur qu’ils soûleront
Tes chers sanglots retentiront
Comme un tambour qui bat la charge !
Ne suis-je pas un faux accord
Dans la divine symphonie,
Grâce à la vorace Ironie
Qui me secoue et qui me mord
Elle est dans ma voix, la criarde !
C’est tout mon sang ce poison noir !
Je suis le sinistre miroir
Où la mégère se regarde.
Je suis la plaie et le couteau !
Je suis le soufflet et la joue !
Je suis les membres et la roue,
Et la victime et le bourreau !
Je suis de mon coeur le vampire,
– Un de ces grands abandonnés
Au rire éternel condamnés
Et qui ne peuvent plus sourire !
LXXXIV – L’IRRÉMÉDIABLE
I
Une Idée, une Forme, un Etre
Parti de l’azur et tombé
Dans un Styx bourbeux et plombé
Où nul oeil du Ciel ne pénètre;
Un Ange, imprudent voyageur
Qu’a tenté l’amour du difforme,
Au fond d’un cauchemar énorme
Se débattant comme un nageur,
Et luttant, angoisses funèbres !
Contre un gigantesque remous
Qui va chantant comme les fous
Et pirouettant dans les ténèbres;
Un malheureux ensorcelé
Dans ses tâtonnements futiles
Pour fuir d’un lieu plein de reptiles,
Cherchant la lumière et la clé;
Un damné descendant sans lampe
Au bord d’un gouffre dont l’odeur
Trahit l’humide profondeur
D’éternels escaliers sans rampe,
Où veillent des monstres visqueux
Dont les larges yeux de phosphore
Font une nuit plus noire encore
Et ne rendent visibles qu’eux;
Un navire pris dans le pôle
Comme en un piège de cristal,
Cherchant par quel détroit fatal
Il est tombé dans cette geôle;
– Emblèmes nets, tableau parfait
D’une fortune irrémédiable
Qui donne à penser que le Diable
Fait toujours bien tout ce qu’il fait !
II
Tête-à-tête sombre et limpide
Qu’un coeur devenu son miroir !
Puits de Vérité, clair et noir
Où tremble une étoile livide,
Un phare ironique, infernal
Flambeau des grâces sataniques,
Soulagement et gloire uniques,
– La conscience dans le Mal !
LXXXV – L’HORLOGE
Horloge ! dieu sinistre, effrayant, impassible,
Dont le doigt nous menace et nous dit: « Souviens-toi !
Les vibrantes Douleurs dans ton coeur plein d’effroi
Se planteront bientôt comme dans une cible;
Le Plaisir vaporeux fuira vers l’horizon
Ainsi qu’une sylphide au fond de la coulisse;
Chaque instant te dévore un morceau du délice
A chaque homme accordé pour toute sa saison.
Trois mille six cents fois par heure, la Seconde
Chuchote: Souviens-toi ! – Rapide, avec sa voix
D’insecte, Maintenant dit: Je suis Autrefois,
Et j’ai pompé ta vie avec ma trompe immonde !
Remember ! Souviens-toi ! prodigue ! Esto memor !
(Mon gosier de métal parle toutes les langues.)
Les minutes, mortel folâtre, sont des gangues
Qu’il ne faut pas lâcher sans en extraire l’or !
Souviens-toi que le Temps est un joueur avide
Qui gagne sans tricher, à tout coup ! c’est la loi.
Le jour décroît; la nuit augmente; souviens-toi !
Le gouffre a toujours soif; la clepsydre se vide.
Tantôt sonnera l’heure où le divin Hasard,
Où l’auguste Vertu, ton épouse encor vierge,
Où le Repentir même (oh ! la dernière auberge !),
Où tout te dira Meurs, vieux lâche ! il est trop tard ! »
TABLEAUX PARISIENS
LXXXVI – PAYSAGE
Je veux, pour composer chastement mes églogues,
Coucher auprès du ciel, comme les astrologues,
Et, voisin des clochers écouter en rêvant
Leurs hymnes solennels emportés par le vent.
Les deux mains au menton, du haut de ma mansarde,
Je verrai l’atelier qui chante et qui bavarde;
Les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité,
Et les grands ciels qui font rêver d’éternité.
II est doux, à travers les brumes, de voir naître
L’étoile dans l’azur, la lampe à la fenêtre
Les fleuves de charbon monter au firmament
Et la lune verser son pâle enchantement.
Je verrai les printemps, les étés, les automnes;
Et quand viendra l’hiver aux neiges monotones,
Je fermerai partout portières et volets
Pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais.
Alors je rêverai des horizons bleuâtres,
Des jardins, des jets d’eau pleurant dans les albâtres,
Des baisers, des oiseaux chantant soir et matin,
Et tout ce que l’Idylle a de plus enfantin.
L’Émeute, tempêtant vainement à ma vitre,
Ne fera pas lever mon front de mon pupitre;
Car je serai plongé dans cette volupté
D’évoquer le Printemps avec ma volonté,
De tirer un soleil de mon coeur, et de faire
De mes pensers brûlants une tiède atmosphère.
LXXXVII – LE SOLEIL
Le long du vieux faubourg, où pendent aux masures
Les persiennes, abri des sécrètes luxures,
Quand le soleil cruel frappe à traits redoublés
Sur la ville et les champs, sur les toits et les blés,
Je vais m’exercer seul à ma fantasque escrime,
Flairant dans tous les coins les hasards de la rime,
Trébuchant sur les mots comme sur les pavés
Heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés.
Ce père nourricier, ennemi des chloroses,
Éveille dans les champs les vers comme les roses;
II fait s’évaporer les soucis vers le ciel,
Et remplit les cerveaux et les ruches le miel.
C’est lui qui rajeunit les porteurs de béquilles
Et les rend gais et doux comme des jeunes filles,
Et commande aux moissons de croître et de mûrir
Dans le coeur immortel qui toujours veut fleurir !
Quand, ainsi qu’un poète, il descend dans les villes,
II ennoblit le sort des choses les plus viles,
Et s’introduit en roi, sans bruit et sans valets,
Dans tous les hôpitaux et dans tous les palais.
LXXXVIII – À UNE MENDIANTE ROUSSE
Blanche fille aux cheveux roux,
Dont la robe par ses trous
Laisse voir la pauvreté
Et la beauté,
Pour moi, poète chétif,
Ton jeune corps maladif,
Plein de taches de rousseur,
A sa douceur.
Tu portes plus galamment
Qu’une reine de roman
Ses cothurnes de velours
Tes sabots lourds.
Au lieu d’un haillon trop court,
Qu’un superbe habit de cour
Traîne à plis bruyants et longs
Sur tes talons;
En place de bas troués
Que pour les yeux des roués
Sur ta jambe un poignard d’or
Reluise encor;
Que des noeuds mal attachés
Dévoilent pour nos péchés
Tes deux beaux seins, radieux
Comme des yeux;
Que pour te déshabiller
Tes bras se fassent prier
Et chassent à coups mutins
Les doigts lutins,
Perles de la plus belle eau,
Sonnets de maître Belleau
Par tes galants mis aux fers
Sans cesse offerts,
Valetaille de rimeurs
Te dédiant leurs primeurs
Et contemplant ton soulier
Sous l’escalier,
Maint page épris du hasard,
Maint seigneur et maint Ronsard
Épieraient pour le déduit
Ton frais réduit !
Tu compterais dans tes lits
Plus de baisers que de lis
Et rangerais sous tes lois
Plus d’un Valois !
– Cependant tu vas gueusant
Quelque vieux débris gisant
Au seuil de quelque Véfour
De carrefour;
Tu vas lorgnant en dessous
Des bijoux de vingt-neuf sous
Dont je ne puis, oh ! Pardon !
Te faire don.
Va donc, sans autre ornement,
Parfum, perles, diamant,
Que ta maigre nudité,
O ma beauté !
LXXXIX – LE CYGNE
À Victor Hugo
I
Andromaque, je pense à vous ! Ce petit fleuve,
Pauvre et triste miroir où jadis resplendit
L’immense majesté de vos douleurs de veuve,
Ce Simoïs menteur qui par vos pleurs grandit,
A fécondé soudain ma mémoire fertile,
Comme je traversais le nouveau Carrousel.
Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville
Change plus vite, hélas ! que le coeur d’un mortel);
Je ne vois qu’en esprit tout ce camp de baraques,
Ces tas de chapiteaux ébauchés et de fûts,
Les herbes, les gros blocs verdis par l’eau des flaques,
Et, brillant aux carreaux, le bric-à-brac confus.
Là s’étalait jadis une ménagerie;
Là je vis, un matin, à l’heure où sous les cieux
Froids et clairs le Travail s’éveille, où la voirie
Pousse un sombre ouragan dans l’air silencieux,
Un cygne qui s’était évadé de sa cage,
Et, de ses pieds palmés frottant le pavé sec,
Sur le sol raboteux traînait son blanc plumage.
Près d’un ruisseau sans eau la bête ouvrant le bec
Baignait nerveusement ses ailes dans la poudre,
Et disait, le coeur plein de son beau lac natal:
« Eau, quand donc pleuvras-tu ? quand tonneras-tu, foudre ? »
Je vois ce malheureux, mythe étrange et fatal,
Vers le ciel quelquefois, comme l’homme d’Ovide,
Vers le ciel ironique et cruellement bleu,
Sur son cou convulsif tendant sa tête avide
Comme s’il adressait des reproches à Dieu !
II
Paris change ! mais rien dans ma mélancolie
N’a bougé ! palais neufs, échafaudages, blocs,
Vieux faubourgs, tout pour moi devient allégorie
Et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs.
Aussi devant ce Louvre une image m’opprime:
Je pense à mon grand cygne, avec ses gestes fous,
Comme les exilés, ridicule et sublime
Et rongé d’un désir sans trêve ! et puis à vous,
Andromaque, des bras d’un grand époux tombée,
Vil bétail, sous la main du superbe Pyrrhus,
Auprès d’un tombeau vide en extase courbée
Veuve d’Hector, hélas ! et femme d’Hélénus !
Je pense à la négresse, amaigrie et phtisique
Piétinant dans la boue, et cherchant, l’oeil hagard,
Les cocotiers absents de la superbe Afrique
Derrière la muraille immense du brouillard;
A quiconque a perdu ce qui ne se retrouve
Jamais, jamais ! à ceux qui s’abreuvent de pleurs
Et tètent la Douleur comme une bonne louve !
Aux maigres orphelins séchant comme des fleurs !
Ainsi dans la forêt où mon esprit s’exile
Un vieux Souvenir sonne à plein souffle du cor !
Je pense aux matelots oubliés dans une île,
Aux captifs, aux vaincus !… à bien d’autres encor !
XC – LES SEPT VIEILLARDS
À Victor Hugo
Fourmillante cité, cité pleine de rêves,
Où le spectre en plein jour raccroche le passant !
Les mystères partout coulent comme des sèves
Dans les canaux étroits du colosse puissant.
Un matin, cependant que dans la triste rue
Les maisons, dont la brume allongeait la hauteur,
Simulaient les deux quais d’une rivière accrue,
Et que, décor semblable à l’âme de l’acteur,
Un brouillard sale et jaune inondait tout l’espace,
Je suivais, roidissant mes nerfs comme un héros
Et discutant avec mon âme déjà lasse,
Le faubourg secoué par les lourds tombereaux.
Tout à coup, un vieillard dont les guenilles jaunes
Imitaient la couleur de ce ciel pluvieux,
Et dont l’aspect aurait fait pleuvoir les aumônes,
Sans la méchanceté qui luisait dans ses yeux,
M’apparut. On eût dit sa prunelle trempée
Dans le fiel; son regard aiguisait les frimas,
Et sa barbe à longs poils, roide comme une épée,
Se projetait, pareille à celle de Judas.
II n’était pas voûté, mais cassé, son échine
Faisant avec sa jambe un parfait angle droit,
Si bien que son bâton, parachevant sa mine,
Lui donnait la tournure et le pas maladroit
D’un quadrupède infirme ou d’un juif à trois pattes.
Dans la neige et la boue il allait s’empêtrant,
Comme s’il écrasait des morts sous ses savates,
Hostile à l’univers plutôt qu’indifférent.
Son pareil le suivait: barbe, oeil, dos, bâton, loques,
Nul trait ne distinguait, du même enfer venu,
Ce jumeau centenaire, et ces spectres baroques
Marchaient du même pas vers un but inconnu.
A quel complot infâme étais-je donc en butte,
Ou quel méchant hasard ainsi m’humiliait ?
Car je comptai sept fois, de minute en minute,
Ce sinistre vieillard qui se multipliait !
Que celui-là qui rit de mon inquiétude
Et qui n’est pas saisi d’un frisson fraternel
Songe bien que malgré tant de décrépitude
Ces sept monstres hideux avaient l’air éternel !
Aurais je, sans mourir, contemplé le huitième,
Sosie inexorable, ironique et fatal
Dégoûtant Phénix, fils et père de lui-même ?
– Mais je tournai le dos au cortège infernal.
Exaspéré comme un ivrogne qui voit double,
Je rentrai, je fermai ma porte, épouvanté,
Malade et morfondu, l’esprit fiévreux et trouble,
Blessé par le mystère et par l’absurdité !
Vainement ma raison voulait prendre la barre;
La tempête en jouant déroutait ses efforts,
Et mon âme dansait, dansait, vieille gabarre
Sans mâts, sur une mer monstrueuse et sans bords !
XCI – LES PETITES VIEILLES
À Victor Hugo
I
Dans les plis sinueux des vieilles capitales,
Où tout, même l’horreur, tourne aux enchantements,
Je guette, obéissant à mes humeurs fatales,
Des êtres singuliers, décrépits et charmants.
Ces monstres disloqués furent jadis des femmes,
Eponine ou Laïs ! Monstres brisés, bossus
Ou tordus, aimons-les ! ce sont encor des âmes.
Sous des jupons troués et sous de froids tissus
Ils rampent, flagellés par les bises iniques,
Frémissant au fracas roulant des omnibus,
Et serrant sur leur flanc, ainsi que des reliques,
Un petit sac brodé de fleurs ou de rébus;
Ils trottent, tout pareils à des marionnettes;
Se traînent, comme font les animaux blessés,
Ou dansent, sans vouloir danser, pauvres sonnettes
Où se pend un Démon sans pitié ! Tout cassés
93
Qu’ils sont, ils ont des yeux perçants comme une vrille,
Luisants comme ces trous où l’eau dort dans la nuit;
Ils ont les yeux divins de la petite fille
Qui s’étonne et qui rit à tout ce qui reluit.
– Avez-vous observé que maints cercueils de vieilles
Sont presque aussi petits que celui d’un enfant ?
La Mort savante met dans ces bières pareilles
Un symbole d’un goût bizarre et captivant,
Et lorsque j’entrevois un fantôme débile
Traversant de Paris le fourmillant tableau,
Il me semble toujours que cet être fragile
S’en va tout doucement vers un nouveau berceau;
A moins que, méditant sur la géométrie,
Je ne cherche, à l’aspect de ces membres discords,
Combien de fois il faut que l’ouvrier varie
La forme de la boîte où l’on met tous ces corps.
– Ces yeux sont des puits faits d’un million de larmes,
Des creusets qu’un métal refroidi pailleta…
Ces yeux mystérieux ont d’invincibles charmes
Pour celui que l’austère Infortune allaita !
II
De Frascati défunt Vestale enamourée;
Prêtresse de Thalie, hélas ! dont le souffleur
Enterré sait le nom; célèbre évaporée
Que Tivoli jadis ombragea dans sa fleur,
Toutes m’enivrent; mais parmi ces êtres frêles
Il en est qui, faisant de la douleur un miel,
Ont dit au Dévouement qui leur prêtait ses ailes:
Hippogriffe puissant, mène-moi jusqu’au ciel !
L’une, par sa patrie au malheur exercée,
L’autre, que son époux surchargea de douleurs,
L’autre, par son enfant Madone transpercée,
Toutes auraient pu faire un fleuve avec leurs pleurs !
III
Ah ! que j’en ai suivi de ces petites vieilles !
Une, entre autres, à l’heure où le soleil tombant
Ensanglante le ciel de blessures vermeilles,
Pensive, s’asseyait à l’écart sur un banc,
Pour entendre un de ces concerts, riches de cuivre,
Dont les soldats parfois inondent nos jardins,
Et qui, dans ces soirs d’or où l’on se sent revivre,
Versent quelque héroïsme au coeur des citadins.
Celle-là, droite encor, fière et sentant la règle,
Humait avidement ce chant vif et guerrier;
Son oeil parfois s’ouvrait comme l’oeil d’un vieil aigle;
Son front de marbre avait l’air fait pour le laurier !
IV
Telles vous cheminez, stoïques et sans plaintes,
A travers le chaos des vivantes cités,
Mères au coeur saignant, courtisanes ou saintes,
Dont autrefois les noms par tous étaient cités.
Vous qui fûtes la grâce ou qui fûtes la gloires,
Nul ne vous reconnaît ! un ivrogne incivil
Vous insulte en passant d’un amour dérisoire;
Sur vos talons gambade un enfant lâche et vil.
Honteuses d’exister, ombres ratatinées,
Peureuses, le dos bas, vous côtoyez les murs;
Et nul ne vous salue, étranges destinées !
Débris d’humanité pour l’éternité mûrs !
Mais moi, moi qui de loin tendrement vous surveille,
L’oeil inquiet, fixé sur vos pas incertains,
Tout comme si j’étais votre père, ô merveille !
Je goûte à votre insu des plaisirs clandestins:
Je vois s’épanouir vos passions novices;
Sombres ou lumineux, je vis vos jours perdus;
Mon coeur multiplié jouit de tous vos vices !
Mon âme resplendit de toutes vos vertus !
Ruines ! ma famille ! ô cerveaux congénères !
Je vous fais chaque soir un solennel adieu !
Où serez-vous demain, Eves octogénaires,
Sur qui pèse la griffe effroyable de Dieu ?
XCII – LES AVEUGLES
Contemple-les, mon âme; ils sont vraiment affreux !
Pareils aux mannequins; vaguement ridicules;
Terribles, singuliers comme les somnambules;
Dardant on ne sait où leurs globes ténébreux.
Leurs yeux, d’où la divine étincelle est partie,
Comme s’ils regardaient au loin, restent levés
Au ciel; on ne les voit jamais vers les pavés
Pencher rêveusement leur tête appesantie.
96
Ils traversent ainsi le noir illimité,
Ce frère du silence éternel. O cité !
Pendant qu’autour de nous tu chantes, ris et beugles,
Éprise du plaisir jusqu’à l’atrocité,
Vois ! je me traîne aussi ! mais, plus qu’eux hébété,
Je dis: Que cherchent-ils au Ciel, tous ces aveugles ?
Les fleurs du mal
Charles Baudelaire
 Cultivons nous
Cultivons nous