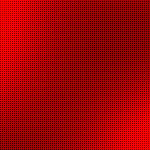Les Caractères De la Chaire
Le discours chrétien est devenu un spectacle. Cette tristesse évangélique qui en est l’âme ne s’y remarque plus: elle est suppléée par les avantages de la mine, par les inflexions de la voix, par la régularité du geste, par le choix des mots, et par les longues énumérations. On n’écoute plus sérieusement la parole sainte: c’est une sorte d’amusement entre mille autres; c’est un jeu où il y a de l’émulation et des parieurs.
L’éloquence profane est transposée pour ainsi dire du barreau, où Le Maître, Pucelle et Fourcroy l’ont fait régner, et où elle n’est plus d’usage, à la chaire, où elle ne doit pas être.
L’on fait assaut d’éloquence jusqu’au pied de l’autel et en la présence des mystères. Celui qui écoute s’établit juge de celui qui prêche, pour condamner ou pour applaudir, et n’est pas plus converti par le discours qu’il favorise que par celui auquel il est contraire. L’orateur plaît aux uns, déplaît aux autres, et convient avec tous en une chose, que, comme il ne cherche point à les rendre meilleurs, ils ne pensent pas aussi à le devenir.
Un apprentif est docile, il écoute son maître, il profite de ses leçons, et il devient maître. L’homme indocile critique le discours du prédicateur, comme le livre du philosophe, et il ne devient ni chrétien ni raisonnable.
Jusqu’à ce qu’il revienne un homme qui, avec un style nourri des saintes Ecritures, explique au peuple la parole divine uniment et familièrement, les orateurs et les déclamateurs seront suivis.
Les citations profanes, les froides allusions, le mauvais pathétique, les antithèses, les figures outrées ont fini: les portraits finiront, et feront place à une simple explication de l’Evangile, jointe aux mouvements qui inspirent la conversion.
Cet homme que je souhaitais impatiemment, et que je ne daignais pas espérer de notre siècle, est enfin venu. Les courtisans, à force de goût et de connaître les bienséances, lui ont applaudi; ils ont, chose incroyable ! abandonné la chapelle du Roi, pour venir entendre avec le peuple la parole de Dieu annoncée par cet homme apostolique. La ville n’a pas été de l’avis de la cour: où il a prêché, les paroissiens ont déserté, jusqu’aux marguilliers ont disparu; les pasteurs ont tenu ferme, mais les ouailles se sont dispersées, et les orateurs voisins en ont grossi leur auditoire. Je devais le prévoir, et ne pas dire qu’un tel homme n’avait qu’à se montrer pour être suivi, et qu’à parler pour être écouté: ne savais-je pas quelle est dans les hommes, et en toutes choses, la force indomptable de l’habitude ? Depuis trente années on prête l’oreille aux rhéteurs, aux déclamateurs, aux énumérateurs; on court ceux qui peignent en grand ou en miniature. Il n’y a pas longtemps qu’ils avaient des chutes ou des transitions ingénieuses, quelquefois même si vives et si aiguës qu’elles pouvaient passer pour épigrammes: ils les ont adoucies, je l’avoue, et ce ne sont plus que des madrigaux. Ils ont toujours, d’une nécessité indispensable et géométrique, trois sujets admirables de vos attentions: ils prouveront une telle chose dans la première partie de leur discours, cette autre dans la seconde partie, et cette autre encore dans la troisième. Ainsi vous serez convaincu d’abord d’une certaine vérité, et c’est leur premier point; d’une autre vérité, et c’est leur second point; et puis d’une troisième vérité, et c’est leur troisième point: de sorte que la première réflexion vous instruira d’un principe des plus fondamentaux de votre religion; la seconde, d’un autre principe qui ne l’est pas moins; et la dernière réflexion, d’un troisième et dernier principe, le plus important de tous, qui est remis pourtant, faute de loisir, à une autre fois. Enfin, pour reprendre et abréger cette division et former un plan… — Encore, dites-vous, et quelles préparations pour un discours de trois quarts d’heure qui leur reste à faire ! Plus ils cherchent à le digérer et à l’éclaircir, plus ils m’embrouillent. — Je vous crois sans peine, et c’est l’effet le plus naturel de tout cet amas d’idées qui reviennent à la même, dont ils chargent sans pitié la mémoire de leurs auditeurs. Il semble, à les voir s’opiniâtrer à cet usage, que la grâce de la conversion soit attachée à ces énormes partitions.
Comment néanmoins serait-on converti par de tels apôtres, si l’on ne peut qu’à peine les entendre articuler, les suivre et ne les pas perdre de vue ? Je leur demanderais volontiers qu’au milieu de leur course impétueuse, ils voulussent plusieurs fois reprendre haleine, souffler un peu, et laisser souffler leurs auditeurs. Vains discours, paroles perdues ! Le temps des homélies n’est plus; les Basiles, les Chrysostomes ne le ramèneraient pas; on passerait en d’autres diocèses pour être hors de la portée de leur voix et de leurs familières instructions. Le commun des hommes aime les phrases et les périodes, admire ce qu’il n’entend pas, se suppose instruit, content de décider entre un premier et un second point, ou entre le dernier sermon et le pénultième.
Il y a moins d’un siècle qu’un livre français était un certain nombre de pages latines, où l’on découvrait quelques lignes ou quelques mots en notre langue. Les passages, les traits et les citations n’en étaient pas demeurés là: Ovide et Catulle achevaient de décider des mariages et des testaments, et venaient avec les Pandectes au secours de la veuve et des pupilles. Le sacré et le profane ne se quittaient point; ils s’étaient glissés ensemble jusque dans la chaire: saint Cyrille, Horace, saint Cyprien, Lucrèce, parlaient alternativement; les poètes étaient de l’avis de saint Augustin et de tous les Pères; on parlait latin, et longtemps, devant des femmes et des marguilliers; on a parlé grec. Il fallait savoir prodigieusement pour prêcher si mal. Autre temps, autre usage: le texte est encore latin, tout le discours est français, et d’un beau français; l’Evangile même n’est pas cité. Il faut savoir aujourd’hui très peu de chose pour bien prêcher.
L’on a enfin banni la scolastique de toutes les chaires des grandes villes, et on l’a reléguée dans les bourgs et dans les villages pour l’instruction et pour le salut du laboureur ou du vigneron.
C’est avoir de l’esprit que de plaire au peuple dans un sermon par un style fleuri, une morale enjouée, des figures réitérées, des traits brillants et de vives descriptions; mais ce n’est point en avoir assez. Un meilleur esprit néglige ces ornements étrangers, indignes de servir à l’Evangile: il prêche simplement, fortement, chrétiennement.
L’orateur fait de si belles images de certains désordres, y fait entrer des circonstances si délicates, met tant d’esprit, de tour et de raffinement dans celui qui pèche, que si je n’ai pas de pente à vouloir ressembler à ses portraits, j’ai besoin du moins que quelque apôtre, avec un style plus chrétien, me dégoûte des vices dont l’on m’avait fait une peinture si agréable.
Un beau sermon est un discours oratoire qui est dans toutes ses règles, purgé de tous ses défauts, conforme aux préceptes de l’éloquence humaine, et paré de tous les ornements de la rhétorique. Ceux qui entendent finement n’en perdent pas le moindre trait ni une seule pensée; ils suivent sans peine l’orateur dans toutes les énumérations où il se promène, comme dans toutes les élévations où il se jette: ce n’est une énigme que pour le peuple.
Le solide et l’admirable discours que celui qu’on vient d’entendre ! Les points de religion les plus essentiels, comme les plus pressants motifs de conversion, y ont été traités: quel grand effet n’a-t-il pas dû faire sur l’esprit et dans l’âme de tous les auditeurs ! Les voilà rendus: ils en sont émus et touchés au point de résoudre dans leur cœur, sur ce sermon de Théodore, qu’il est encore plus beau que le dernier qu’il a prêché.
La morale douce et relâchée tombe avec celui qui la prêche; elle n’a rien qui réveille et qui pique la curiosité d’un homme du monde, qui craint moins qu’on ne pense une doctrine sévère, et qui l’aime même dans celui qui fait son devoir en l’annonçant. Il semble donc qu’il y ait dans l’Eglise comme deux états qui doivent la partager: celui de dire la vérité dans toute son étendue, sans égards, sans déguisement; celui de l’écouter avidement, avec goût, avec admiration, avec éloges, et de n’en faire cependant ni pis ni mieux.
L’on peut faire ce reproche à l’héroïque vertu des grands hommes, qu’elle a corrompu l’éloquence, ou du moins amolli le style de la plupart des prédicateurs. Au lieu de s’unir seulement avec les peuples pour bénir le Ciel de si rares présents qui en sont venus, ils ont entré en société avec les auteurs et les poètes; et devenus comme eux panégyristes, ils ont enchéri sur les épîtres dédicatoires, sur les stances et sur les prologues; ils ont changé la parole sainte en un tissu de louanges, justes à la vérité, mais mal placées, intéressées, que personne n’exige d’eux, et qui ne conviennent point à leur caractère. On est heureux si à l’occasion du héros qu’ils célèbrent jusque dans le sanctuaire, ils disent un mot de Dieu et du mystère qu’ils devaient prêcher. Il s’en est trouvé quelques-uns qui ayant assujetti le saint Evangile, qui doit être commun à tous, à la présence d’un seul auditeur, se sont vus déconcertés par des hasards qui le retenaient ailleurs, n’ont pu prononcer devant des chrétiens un discours chrétien qui n’était pas fait pour eux, et ont été suppléés par d’autres orateurs, qui n’ont eu le temps que de louer Dieu dans un sermon précipité.
Théodule a moins réussi que quelques-uns de ses auditeurs ne l’appréhendaient: ils sont contents de lui et de son discours; il a mieux fait à leur gré que de charmer l’esprit et les oreilles, qui est de flatter leur jalousie.
Le métier de la parole ressemble en une chose à celui de la guerre: il y a plus de risque qu’ailleurs, mais la fortune y est plus rapide.
Si vous êtes d’une certaine qualité, et que vous ne vous sentiez point d’autre talent que celui de faire de froids discours, prêchez, faites de froids discours: il n’y a rien de pire pour sa fortune que d’être entièrement ignoré. Théodat a été payé de ses mauvaises phrases et de son ennuyeuse monotonie.
L’on a eu de grands évêchés par un mérite de chaire qui présentement ne vaudrait pas à son homme une simple prébende.
Le nom de ce panégyriste semble gémir sous le poids des titres dont il est accablé; leur grand nombre remplit de vastes affiches qui sont distribuées dans les maisons, ou que l’on lit par les rues en caractères monstrueux, et qu’on ne peut non plus ignorer que la place publique. Quand sur une si belle montre, l’on a seulement essayé du personnage, et qu’on l’a un peu écouté, l’on reconnaît qu’il manque au dénombrement de ses qualités celle de mauvais prédicateur.
L’oisiveté des femmes, et l’habitude qu’ont les hommes de les courir partout où elles s’assemblent, donnent du nom à de froids orateurs, et soutiennent quelque temps ceux qui ont décliné.
Devrait-il suffire d’avoir été grand et puissant dans le monde pour être louable ou non, et, devant le saint autel et dans la chaire de la vérité, loué et célébré à ses funérailles ? N’y a-t-il point d’autre grandeur que celle qui vient de l’autorité et de la naissance ? Pourquoi n’est-il pas établi de faire publiquement le panégyrique d’un homme qui a excellé pendant sa vie dans la bonté, dans l’équité, dans la douceur, dans la fidélité, dans la piété ? Ce qu’on appelle une oraison funèbre n’est aujourd’hui bien reçue du plus grand nombre des auditeurs, qu’à mesure qu’elle s’éloigne davantage du discours chrétien, ou si vous l’aimez mieux ainsi, qu’elle approche de plus près d’un éloge profane.
L’orateur cherche par ses discours un évêché; l’apôtre fait des conversions: il mérite de trouver ce que l’autre cherche.
L’on voit des clercs revenir de quelques provinces où ils n’ont pas fait un long séjour, vains des conversions qu’ils ont trouvées toutes faites, comme de celles qu’ils n’ont pu faire, se comparer déjà aux Vincents et aux Xaviers, et se croire des hommes apostoliques: de si grands travaux et de si heureuses missions ne seraient pas à leur gré payés d’une abbaye.
Tel tout d’un coup, et sans y avoir pensé la veille, prend du papier, une plume, dit en soi-même: “ Je vais faire un livre “, sans autre talent pour écrire que le besoin qu’il a de cinquante pistoles. Je lui crie inutilement: ” Prenez une scie, Dioscore, sciez, ou bien tournez, ou faites une jante de roue; vous aurez votre salaire. ” Il n’a point fait l’apprentissage de tous ces métiers. ” Copiez donc, transcrivez, soyez au plus correcteur d’imprimerie, n’écrivez point. ” Il veut écrire et faire imprimer; et parce qu’on n’envoie pas à l’imprimeur un cahier blanc, il le barbouille de ce qui lui plaît: il écrirait volontiers que la Seine coule à Paris, qu’il y a sept jours dans la semaine, ou que le temps est à la pluie; et comme ce discours n’est ni contre la religion ni contre l’Etat, et qu’il ne fera point d’autre désordre dans le public que de lui gâter le goût et l’accoutumer aux choses fades et insipides, il passe à l’examen, il est imprimé, et à la honte du siècle, comme pour l’humiliation des bons auteurs, réimprimé. De même un homme dit en son cœur: “ Je prêcherai “, et il prêche; le voilà en chaire, sans autre talent ni vocation que le besoin d’un bénéfice.
Un clerc mondain ou irréligieux, s’il monte en chaire, est déclamateur.
Il y a au contraire des hommes saints, et dont le seul caractère est efficace pour la persuasion: ils paraissent, et tout un peuple qui doit les écouter est déjà ému et comme persuadé par leur présence; le discours qu’ils vont prononcer fera le reste.
L’. de Meaux et le P. Bourdaloue me rappellent Démosthène et Cicéron. Tous deux, maîtres dans l’éloquence de la chaire, ont eu le destin des grands modèles: l’un a fait de mauvais censeurs, l’autre de mauvais copistes.
L’éloquence de la chaire, en ce qui y entre d’humain et du talent de l’orateur, est cachée, connue de peu de personnes et d’une difficile exécution: quel art en ce genre pour plaire en persuadant ! Il faut marcher par des chemins battus, dire ce qui a été dit, et ce que l’on prévoit que vous allez dire. Les matières sont grandes, mais usées et triviales; les principes sûrs, mais dont les auditeurs pénètrent les conclusions d’une seule vue. Il y entre des sujets qui sont sublimes; mais qui peut traiter le sublime ? Il y a des mystères que l’on doit expliquer, et qui s’expliquent mieux par une leçon de l’école que par un discours oratoire. La morale même de la chaire, qui comprend une matière aussi vaste et aussi diversifiée que le sont les mœurs des hommes, roule sur les mêmes pivots, retrace les mêmes images, et se prescrit des bornes bien plus étroites que la satire: après l’invective commune contre les honneurs, les richesses et le plaisir, il ne reste plus à l’orateur qu’à courir à la fin de son discours et à congédier l’assemblée. Si quelquefois on pleure, si on est ému, après avoir fait attention au génie et au caractère de ceux qui font pleurer, peut-être conviendra-t-on que c’est la matière qui se prêche elle-même, et notre intérêt le plus capital qui se fait sentir; que c’est moins une véritable éloquence que la ferme poitrine du missionnaire qui nous ébranle et qui cause en nous ces mouvements. Enfin le prédicateur n’est point soutenu, comme l’avocat, par des faits toujours nouveaux, par de différents événements, par des aventures inouïes; il ne s’exerce point sur les questions douteuses, il ne fait point valoir les violentes conjectures et les présomptions, toutes choses néanmoins qui élèvent le génie, lui donnent de la force et de l’étendue, et qui contraignent bien moins l’éloquence qu’elles ne la fixent et ne la dirigent. Il doit au contraire tirer son discours d’une source commune, et où tout le monde puise; et s’il s’écarte de ces lieux communs, il n’est plus populaire, il est abstrait ou déclamateur, il ne prêche plus l’Evangile. Il n’a besoin que d’une noble simplicité, mais il faut l’atteindre, talent rare, et qui passe les forces du commun des hommes: ce qu’ils ont de génie, d’imagination, d’érudition et de mémoire, ne leur sert souvent qu’à s’en éloigner.
La fonction de l’avocat est pénible, laborieuse, et suppose, dans celui qui l’exerce, un riche fonds et de grandes ressources. Il n’est pas seulement chargé, comme le prédicateur, d’un certain nombre d’oraisons composées avec loisir, récitées de mémoire, avec autorité, sans contradicteurs, et qui, avec de médiocres changements, lui font honneur plus d’une fois; il prononce de graves plaidoyers devant des juges qui peuvent lui imposer silence, et conte des adversaires qui l’interrompent; il doit être prêt sur la réplique; il parle en un même jour, dans divers tribunaux, de différentes affaires. Sa maison n’est pas pour lui un lieu de repos et de retraite, ni un asile contre les plaideurs; elle est ouverte à tous ceux qui viennent l’accabler de leurs questions et de leurs doutes. Il ne se met pas au lit, on ne l’essuie point, on ne lui prépare point des rafraîchissements; il ne se fait point dans sa chambre un concours de monde de tous les états et de tous les sexes, pour le féliciter sur l’agrément et sur la politesse de son langage, lui remettre l’esprit sur un endroit où il a couru risque de demeurer court, ou sur un scrupule qu’il a sur le chevet d’avoir plaidé moins vivement qu’à l’ordinaire. Il se délasse d’un long discours par de plus longs écrits, il ne fait que changer de travaux et de fatigues: j’ose dire qu’il est dans son genre ce qu’étaient dans le leur les premiers hommes apostoliques.
Quand on a ainsi distingué l’éloquence du barreau de la fonction de l’avocat, et l’éloquence de la chaire du ministère du prédicateur, on croit voir qu’il est plus aisé de prêcher que de plaider, et plus difficile de bien prêcher que de bien plaider.
Quel avantage n’a pas un discours prononcé sur un ouvrage qui est écrit ! Les hommes sont les dupes de l’action et de la parole, comme de tout l’appareil de l’auditoire. Pour peu de prévention qu’ils aient en faveur de celui qui parle, ils l’admirent, et cherchent ensuite à le comprendre: avant qu’il ait commencé, ils s’écrient qu’il va bien faire; ils s’endorment bientôt, et le discours fini, ils se réveillent pour dire qu’il a bien fait. On se passionne moins pour un auteur: son ouvrage est lu dans le loisir de la campagne, ou dans le silence du cabinet; il n’y a point de rendez-vous publics pour lui applaudir, encore moins de cabale pour lui sacrifier tous ses rivaux, et pour l’élever à la prélature. On lit son livre, quelque excellent qu’il soit, dans l’esprit de le trouver médiocre; on le feuillette, on le discute, on le confronte; ce ne sont pas des sons qui se perdent en l’air et qui s’oublient; ce qui est imprimé demeure imprimé. On l’attend quelquefois plusieurs jours avant l’impression pour le décrier, et le plaisir le plus délicat que l’on en tire vient de la critique qu’on en fait; on est piqué d’y trouver à chaque page des traits qui doivent plaire, on va même souvent jusqu’à appréhender d’en être diverti, et on ne quitte ce livre que parce qu’il est bon. Tout le monde ne se donne pas pour orateur: les phrases, les figures, le don de la mémoire, la robe ou l’engagement de celui qui prêche, ne sont pas des choses qu’on ose ou qu’on veuille toujours s’approprier. Chacun au contraire croit penser bien, et écrire encore mieux ce qu’il a pensé; il en est moins favorable à celui qui pense et qui écrit aussi bien que lui. En un mot le sermonneur est plus tôt évêque que le plus solide écrivain n’est revêtu d’un prieuré simple; et dans la distribution des grâces, de nouvelles sont accordées à celui-là, pendant que l’auteur grave se tient heureux d’avoir ses restes.
S’il arrive que les méchants vous haïssent et vous persécutent, les gens de bien vous conseillent de vous humilier devant Dieu, pour vous mettre en garde contre la vanité qui pourrait vous venir de déplaire à des gens de ce caractère; de même si certains hommes, sujets à se récrier sur le médiocre, désapprouvent un ouvrage que vous aurez écrit, ou un discours que vous venez de prononcer en public, soit au barreau, soit dans la chaire, ou ailleurs, humiliez-vous: on ne peut guère être exposé à une tentation d’orgueil plus délicate et plus prochaine.
Il me semble qu’un prédicateur devrait faire choix dans chaque discours d’une vérité unique, mais capitale, terrible ou instructive, la manier à fond et l’épuiser; abandonner toutes ces divisions si recherchées, si retournées, si remaniées et si différenciées; ne point supposer ce qui est faux, je veux dire que le grand ou le beau monde sait sa religion et ses devoirs; et ne pas appréhender de faire, ou à ces bonnes têtes ou à ces esprits si raffinés, des catéchismes; ce temps si long que l’on use à composer un long ouvrage, l’employer à se rendre si maître de sa matière, que le tour et les expressions naissent dans l’action, et coulent de source; se livrer, après une certaine préparation, à son génie et au mouvement qu’un grand sujet peut inspirer: qu’il pourrait enfin s’épargner ces prodigieux efforts de mémoire qui ressemblent mieux à une gageure qu’à une affaire sérieuse, qui corrompent le geste et défigurent le visage; jeter au contraire, par un bel enthousiasme, la persuasion dans les esprits et l’alarme dans le cœur, et toucher ses auditeurs d’une tout autre crainte que de celle de le voir demeurer court.
Que celui qui n’est pas encore assez parfait pour s’oublier soi-même dans le ministère de la parole sainte ne se décourage point par les règles austères qu’on lui prescrit, comme si elles lui ôtaient les moyens de faire montre de son esprit, et de monter aux dignités où il aspire: quel plus beau talent que celui de prêcher apostoliquement ? et quel autre mérite mieux un évêché ? Fénelon en était-il indigne ? aurait-il pu échapper au choix du Prince que par un autre choix ? Des esprits forts
Les esprits forts savent-ils qu’on les appelle ainsi par ironie ? Quelle plus grande faiblesse que d’être incertains quel est le principe de son être, de sa vie, de ses sens, de ses connaissances, et quelle en doit être la fin ? Quel découragement plus grand que de douter si son âme n’est point matière comme la pierre et le reptile, et si elle n’est point corruptible comme ces viles créatures ? N’y a-t-il pas plus de force et de grandeur à recevoir dans notre esprit l’idée d’un être supérieur à tous les êtres, qui les a tous faits, et à qui tous se doivent rapporter; d’un être souverainement parfait, qui est pur, qui n’a point commencé et qui ne peut finir, dont notre âme est l’image, et si j’ose dire, une portion, comme esprit et comme immortelle ?
Le docile et le faible sont susceptibles d’impressions: l’un en reçoit de bonnes, l’autre de mauvaises; c’est-à-dire que le premier est persuadé et fidèle, et que le second est entêté et corrompu. Ainsi l’esprit docile admet la vraie religion; et l’esprit faible, ou n’en admet aucune, ou en admet une fausse. Or l’esprit fort ou n’a point de religion, ou se fait une religion; donc l’esprit fort, c’est l’esprit faible.
J’appelle mondains, terrestres ou grossiers ceux dont l’esprit et le cœur sont attachés à une petite portion de ce monde qu’ils habitent, qui est la terre; qui n’estiment rien, qui n’aiment rien au delà: gens aussi limités que ce qu’ils appellent leurs possessions ou leur domaine, que l’on mesure, dont on compte les arpents, et dont on montre les bornes. Je ne m’étonne pas que des hommes qui s’appuient sur un atome chancellent dans les moindres efforts qu’ils font pour sonder la vérité, si avec des vues si courtes ils ne percent point à travers le ciel et les astres, jusques à Dieu même; si, ne s’apercevant point ou de l’excellence de ce qui est esprit, ou de la dignité de l’âme, ils ressentent encore moins combien elle est difficile à assouvir, combien la terre entière est au-dessous d’elle, de quelle nécessité lui devient un être souverainement parfait, qui est Dieu, et quel besoin indispensable elle a d’une religion qui le lui indique, et qui lui en est une caution sûre. Je comprends au contraire fort aisément qu’il est naturel à de tels esprits de tomber dans l’incrédulité ou l’indifférence, et de faire servir Dieu et la religion à la politique, c’est-à-dire à l’ordre et à la décoration de ce monde, la seule chose selon eux qui mérite qu’on y pense.
Quelques-uns achèvent de se corrompre par de longs voyages, et perdent le peu de religion qui leur restait. Ils voient de jour à autre un nouveau culte, diverses mœurs, diverses cérémonies; ils ressemblent à ceux qui entrent dans les magasins, indéterminés sur le choix des étoffes qu’ils veulent acheter: le grand nombre de celles qu’on leur montre les rend plus indifférents; elles ont chacune leur agrément et leur bienséance: ils ne se fixent point, ils sortent sans emplette.
Il y a des hommes qui attendent à être dévots et religieux que tout le monde se déclare impie et libertin: ce sera alors le parti du vulgaire, ils sauront s’en dégager. La singularité leur plaît dans une matière si sérieuse et si profonde; ils ne suivent la mode et le train commun que dans les choses de rien et de nulle suite. Qui sait même s’ils n’ont pas déjà mis une sorte de bravoure et d’intrépidité à courir tout le risque de l’avenir ? Il ne faut pas d’ailleurs que dans une certaine condition, avec une certaine étendue d’esprit et de certaines vues, l’on songe à croire comme les savants et le peuple.
L’on doute de Dieu dans une pleine santé, comme l’on doute que ce soit pécher que d’avoir un commerce avec une personne libre. Quand l’on devient malade, et que l’hydropisie est formée, l’on quitte sa concubine, et l’on croit en Dieu.
Il faudrait s’éprouver et s’examiner très sérieusement, avant que de se déclarer esprit fort ou libertin, afin au moins, et selon ses principes, de finir comme l’on a vécu; ou si l’on ne se sent pas la force d’aller si loin, se résoudre de vivre comme l’on veut mourir.
Toute plaisanterie dans un homme mourant est hors de sa place: si elle roule sur de certains chapitres, elle est funeste. C’est une extrême misère que de donner à ses dépens à ceux que l’on laisse le plaisir d’un bon mot.
Dans quelque prévention où l’on puisse être sur ce qui doit suivre la mort, c’est une chose bien sérieuse que de mourir: ce n’est point alors le badinage qui sied bien, mais la constance.
Il y a eu de tout temps de ces gens d’un bel esprit et d’une agréable littérature, esclaves des grands, dont ils ont épousé le libertinage et porté le joug toute leur vie, contre leurs propres lumières et contre leur conscience. Ces hommes n’ont jamais vécu que pour d’autres hommes, et ils semblent les avoir regardés comme leur dernière fin. Ils ont eu honte de se sauver à leurs yeux, de paraître tels qu’ils étaient peut-être dans le cœur, et ils se sont perdus par déférence ou par faiblesse. Y a-t-il donc sur la terre des grands assez grands, et des puissants assez puissants, pour mériter de nous que nous croyions et que nous vivions à leur gré, selon leur goût et leurs caprices, et que nous poussions la complaisance plus loin, en mourant non de la manière qui est la plus sûre pour nous, mais de celle qui leur plaît davantage ?
J’exigerais de ceux qui vont contre le train commun et les grandes règles qu’il sussent plus que les autres, qu’ils eussent des raisons claires, et de ces arguments qui emportent conviction.
Je voudrais voir un homme sobre, modéré, chaste, équitable, prononcer qu’il n’y a point de Dieu: il parlerait du moins sans intérêt; mais cet homme ne se trouve point.
J’aurais une extrême curiosité de voir celui qui serait persuadé que Dieu n’est point: il me dirait du moins la raison invincible qui a su le convaincre.
L’impossibilité où je suis de prouver que Dieu n’est pas me découvre son existence.
Dieu condamne et punit ceux qui l’offensent, seul juge en sa propre cause: ce qui répugne, s’il n’est lui-même la justice et la vérité, c’est-à-dire s’il n’est Dieu.
Je sens qu’il y a un Dieu, et je ne sens pas qu’il n’y en ait point; cela me suffit, tout le raisonnement du monde m’est inutile: je conclus que Dieu existe. Cette conclusion est dans ma nature; j’en ai reçu les principes trop aisément dans mon enfance, et je les ai conservés depuis trop naturellement dans un âge plus avancé, pour les soupçonner de fausseté. — Mais il y a des esprits qui se défont de ces principes. — C’est une grande question s’il s’en trouve de tels; et quand il serait ainsi, cela prouve seulement qu’il y a des monstres.
L’athéisme n’est point. Les grands, qui en sont le plus soupçonnés, sont trop paresseux pour décider en leur esprit que Dieu n’est pas; leur indolence va jusqu’à les rendre froids et indifférents sur cet article si capital, comme sur la nature de leur âme, et sur les conséquences d’une vraie religion; ils ne nient ces choses ni ne les accordent: ils n’y pensent point.
Nous n’avons pas trop de toute notre santé, de toutes nos forces et de tout notre esprit pour penser aux hommes ou au plus petit intérêt: il semble au contraire que la bienséance et la coutume exigent de nous que nous ne pensions à Dieu que dans un état où il ne reste en nous qu’autant de raison qu’il faut pour ne pas dire qu’il n’y en a plus.
Un grand croit s’évanouir, et il meurt; un autre grand périt insensiblement, et perd chaque jour quelque chose de soi-même avant qu’il soit éteint: formidables leçons, mais inutiles ! Des circonstances si marquées et si sensiblement opposées ne se relèvent point et ne touchent personne: les hommes n’y ont pas plus d’attention qu’à une fleur qui se fane ou à une feuille qui tombe; ils envient les places qui demeurent vacantes, ou ils s’informent si elles sont remplies, et par qui.
Les hommes sont-ils assez bons, assez fidèles, assez équitables, pour mériter toute notre confiance, et ne nous pas faire désirer du moins que Dieu existât, à qui nous pussions appeler de leurs jugements et avoir recours quand nous en sommes persécutés ou trahis ?
Si c’est le grand et le sublime de la religion qui éblouit ou qui confond les esprits forts, ils ne sont plus des esprits forts, mais de faibles génies et de petits esprits; et si c’est au contraire ce qu’il y a d’humble et de simple qui les rebute, ils sont à la vérité des esprits forts, et plus forts que tant de grands hommes si éclairés, si élevés, et néanmoins si fidèles, que les Léons, les Basiles, les Jéromes, les Augustins.
” Un Père de l’Eglise, un docteur de l’Eglise, quels noms ! quelle tristesse dans leurs écrits ! quelle sécheresse, quelle froide dévotion, et peut-être quelle scolastique ! ” disent ceux qui ne les ont jamais lus. Mais plutôt quel étonnement pour tous ceux qui se sont fait une idée des Pères si éloignée de la vérité, s’ils voyaient dans leurs ouvrages plus de tour et de délicatesse, plus de politesse et d’esprit, plus de richesse d’expression et plus de force de raisonnement, des traits plus vifs et des grâces plus naturelles que l’on n’en remarque dans la plupart des livres de ce temps qui sont lus avec goût, qui donnent du nom et de la vanité à leurs auteurs ! Quel plaisir d’aimer la religion, et de la voir crue, soutenue, expliquée par de si beaux génies, et par de si solides esprits ! surtout lorsque l’on vient à connaître que pour l’étendue de connaissance, pour la profondeur et la pénétration, pour les principes de la pure philosophie, pour leur application et leur développement, pour la justesse des conclusions, pour la dignité du discours, pour la beauté de la morale et des sentiments, il n’y a rien par exemple que l’on puisse comparer à S. Augustin, que Platon et que Cicéron.
L’homme est né menteur: la vérité est simple et ingénue, et il veut du spécieux et de l’ornement. Elle n’est pas à lui, elle vient du ciel toute faite, pour ainsi dire, et dans toute sa perfection; et l’homme n’aime que son propre ouvrage, la fiction et la fable. Voyez le peuple: il controuve, il augmente, il charge par grossièreté et par sottise; demandez même au plus honnête homme s’il est toujours vrai dans ses discours, s’il ne se surprend pas quelquefois dans des déguisements où engagent nécessairement la vanité et la légèreté, si pour faire un meilleur conte, il ne lui échappe pas souvent d’ajouter à un fait qu’il récite une circonstance qui y manque. Une chose arrive aujourd’hui, et presque sous nos yeux: cent personnes qui l’ont vue la racontent en cent façons différentes; celui-ci, s’il est écouté, la dira encore d’une manière qui n’a pas été dite. Quelle créance donc pourrais-je donner à des faits qui sont anciens et éloignés de nous par plusieurs siècles ? quel fondement dois-je faire sur les plus graves historiens ? que devient l’histoire ? César a-t-il été massacré au milieu du sénat ? y a-t-il eu un César ? ” Quelle conséquence ! me dites-vous; quels doutes ! quelle demande ! ” Vous riez, vous ne me jugez pas digne d’aucune réponse; et je crois même que vous avez raison. Je suppose néanmoins que le livre qui fait mention de César ne soit pas un livre profane, écrit de la main des hommes, qui sont menteurs, trouvé par hasard dans les bibliothèques parmi d’autres manuscrits qui contiennent des histoires vraies ou apocryphes; qu’au contraire il soit inspiré, saint, divin; qu’il porte en soi ces caractères; qu’il se trouve depuis près de deux mille ans dans une société nombreuse qui n’a pas permis qu’on y ait fait pendant tout ce temps la moindre altération, et qui s’est fait une religion de le conserver dans toute son intégrité; qu’il y ait même un engagement religieux et indispensable d’avoir de la foi pour tous les faits contenus dans ce volume où il est parlé de César et de sa dictature: avouez-le, Lucile, vous douterez alors qu’il y ait eu un César.
Toute musique n’est pas propre à louer Dieu et à être entendue dans le sanctuaire; toute philosophie ne parle pas dignement de Dieu, de sa puissance, des principes de ses opérations et de ses mystères: plus cette philosophie est subtile et idéale, plus elle est vaine et inutile pour expliquer des choses qui ne demandent des hommes qu’un sens droit pour être connues jusques à un certain point, et qui au delà sont inexplicables. Vouloir rendre raison de Dieu, de ses perfections, et si j’ose ainsi parler, de ses actions, c’est aller plus loin que les anciens philosophes, que les Apôtres, que les premiers docteurs, mais ce n’est pas rencontrer si juste; c’est creuser longtemps et profondément, sans trouver les sources de la vérité. Dès qu’on a abandonné les termes de bonté, de miséricorde, de justice et de toute-puissance, qui donnent de Dieu de si hautes et de si aimables idées, quelque grand effort d’imagination qu’on puisse faire, il faut recevoir les expressions sèches, stériles, vides de sens; admettre les pensées creuses, écartées des notions communes, ou tout au plus les subtiles et les ingénieuses; et à mesure que l’on acquiert d’ouverture dans une nouvelle métaphysique, perdre un peu de sa religion.
Jusques où les hommes ne se portent-ils point par l’intérêt de la religion, dont ils sont si peu persuadés, et qu’ils pratiquent si mal !
Cette même religion que les hommes défendent avec chaleur et avec zèle contre ceux qui en ont une toute contraire, ils l’altèrent eux-mêmes dans leur esprit par des sentiments particuliers: ils y ajoutent et ils en retranchent mille choses souvent essentielles, selon ce qui leur convient, et ils demeurent fermes et inébranlables dans cette forme qu’ils lui ont donnée. Ainsi, à parler populairement, on peut dire d’une seule nation qu’elle vit sous un même culte, et qu’elle n’a qu’une seule religion; mais, à parler exactement, il est vrai qu’elle en a plusieurs, et que chacun presque y a la sienne.
Deux sortes de gens fleurissent dans les cours, et y dominent dans divers temps, les libertins et les hypocrites: ceux-là gaiement, ouvertement, sans art et sans dissimulation; ceux-ci finement, par des artifices, par la cabale. Cent fois plus épris de la fortune que les premiers, ils en sont jaloux jusqu’à l’excès; ils veulent la gouverner, la posséder seuls, la partager entre eux et en exclure tout autre; dignités, charges, postes, bénéfices, pensions, honneurs, tout leur convient et ne convient qu’à eux; le reste des hommes en est indigne; ils ne comprennent point que sans leur attache on ait l’impudence de les espérer. Une troupe de masques entre dans un bal: ont-ils la main, ils dansent, ils se font danser les uns les autres, ils dansent encore, ils dansent toujours; ils ne rendent la main à personne de l’assemblée, quelque digne qu’elle soit de leur attention: on languit, on sèche de les voir danser et de ne danser point: quelques-uns murmurent; les plus sages prennent leur parti et s’en vont.
Il y a deux espèces de libertins: les libertins, ceux du moins qui croient l’être, et les hypocrites ou faux dévots, c’est-à-dire ceux qui ne veulent pas être crus libertins: les derniers dans ce genre-là sont les meilleurs.
Le faux dévot ou ne croit pas en Dieu, ou se moque de Dieu; parlons de lui obligeamment: il ne croit pas en Dieu.
Les Caractères ou les Moeurs de ce siècle par Jean de La Bruyère
 Cultivons nous
Cultivons nous